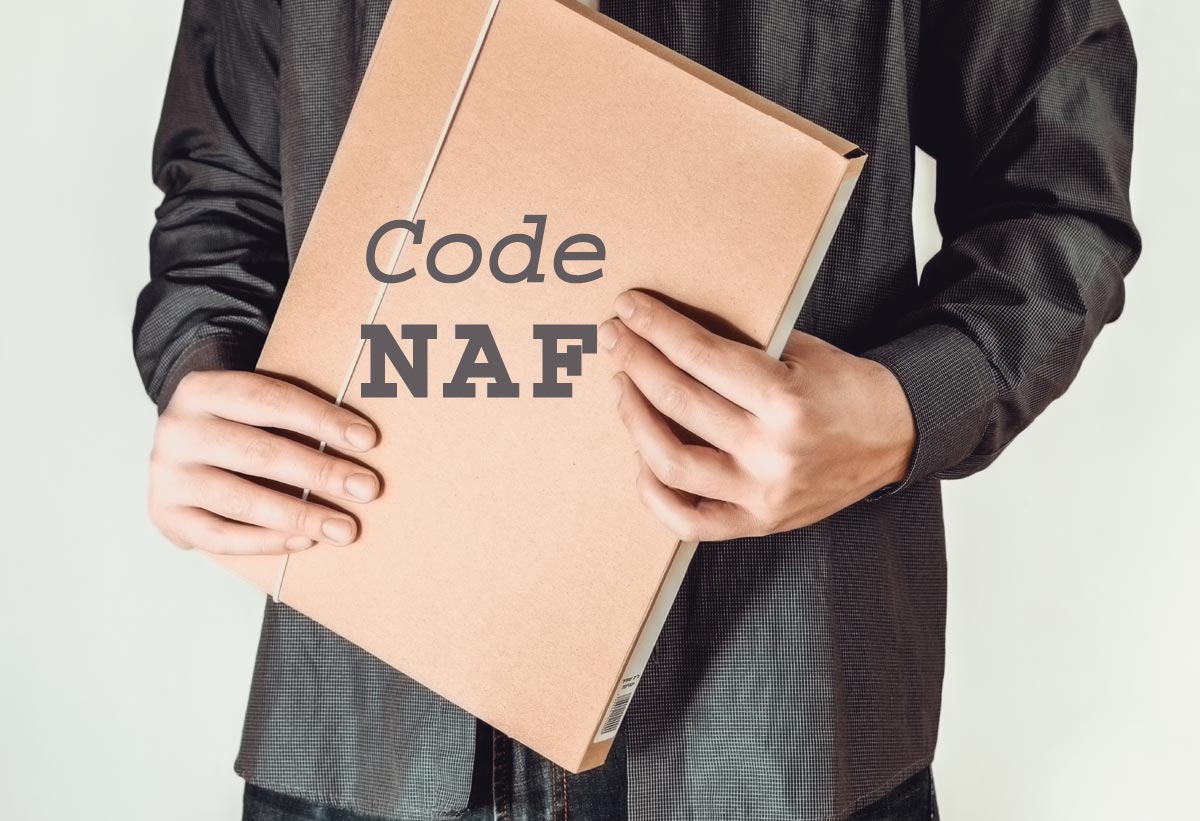L’internationalisation d’une entreprise désigne le processus par lequel celle-ci étend ses activités au-delà de ses frontières nationales. Ce mouvement vers l’ouverture de nouveaux marchés étrangers est devenu courant dans un contexte économique toujours plus mondialisé. Il s’agit pour une société de développer sa présence commerciale ou industrielle au niveau international, afin de tirer parti d’opportunités de croissance hors de son marché domestique.
Plan de l'article
Mettre en place une stratégie d’internationalisation efficace permet à l’entreprise de planifier et de structurer cette expansion au niveau mondial. Cela implique de définir des objectifs clairs, des pays cibles prioritaires et les moyens à mobiliser pour réussir son développement à l’étranger.
Stratégie d’internationalisation
Définition : Une stratégie d’internationalisation est un plan d’action global qui détermine comment une entreprise va se développer à l’international. Elle précise les objectifs à atteindre sur les marchés extérieurs, les ressources à engager, ainsi que les choix opérationnels (pays à cibler, mode d’entrée, partenariats, etc.). En d’autres termes, c’est la feuille de route qui guide l’entreprise dans son expansion hors de son marché national.
Quelles sont les stratégies d’internationalisation ?
Il existe plusieurs façons pour une entreprise de s’internationaliser. On distingue notamment cinq stratégies principales qui correspondent à des logiques différentes de développement à l’étranger : conquérir un marché ciblé en priorité, rechercher l’échelle et les volumes à l’international, valoriser des ressources ou compétences spécifiques au-delà des frontières, diversifier ses activités via l’export, ou s’engager dans des alliances stratégiques avec des partenaires à l‘étranger. Ce sont les grandes orientations qu’une entreprise peut combiner selon son contexte.
Les enjeux d’une stratégie d’internationalisation
Se développer à l’international comporte des implications majeures pour l’entreprise. Il faut prendre en compte des réalités nouvelles : un environnement concurrentiel différent, des cultures et habitudes de consommation étrangères, ainsi que des contraintes réglementaires et logistiques propres à chaque pays. Réussir son internationalisation nécessite donc d’adapter son offre et son organisation interne.
Par exemple, une entreprise devra souvent ajuster ses produits ou services aux préférences locales, mettre en place une chaîne d’approvisionnement internationale fiable, et s’assurer de respecter les lois et normes du pays visé. Une bonne exécution peut apporter une croissance significative, tandis qu’un échec pourrait entraîner des pertes financières et nuire à l’image de l’entreprise.
Les motifs de l’internationalisation
Plusieurs motivations poussent les entreprises à s’engager dans une stratégie d’internationalisation. D’abord, la recherche de nouveaux marchés et de nouveaux clients figure parmi les principaux motifs : lorsqu’un marché domestique est saturé ou arrive à maturité, s’ouvrir à l’extérieur permet de trouver des relais de croissance. Ensuite, l’internationalisation sert souvent à diversifier les risques en évitant de dépendre d’une seule économie : en étant présente dans plusieurs pays, une entreprise peut compenser les fluctuations ou crises d’un marché par la bonne santé d’un autre.
Par ailleurs, s’implanter à l’étranger peut donner accès à des ressources stratégiques (matières premières, talents, technologies) ou à des synergies qui ne sont pas disponibles sur le marché domestique. Enfin, s’internationaliser peut améliorer la compétitivité globale de l’entreprise, par exemple en augmentant les volumes de production (ce qui réduit les coûts unitaires) ou en renforçant la notoriété de la marque à l’échelle mondiale.
Les moteurs de l’internationalisation
Au-delà des motivations internes, il existe des moteurs externes qui favorisent l’internationalisation des entreprises. La mondialisation économique en est un facteur majeur : la baisse des barrières commerciales et l’amélioration des transports et communications facilitent l’accès à des marchés lointains. De même, la digitalisation et le commerce en ligne permettent aujourd’hui à de plus petites structures de toucher une clientèle internationale sans présence physique initiale.
La pression concurrentielle joue également un rôle : si des concurrents se positionnent à l’étranger ou si des marchés étrangers offrent un avantage compétitif (coûts de production plus bas, fiscalité avantageuse), une entreprise peut être incitée à suivre le mouvement pour ne pas perdre de terrain. Enfin, les soutiens publics (comme les accords commerciaux internationaux ou les subventions à l’export) et l’existence de marchés régionaux intégrés (ex. l’Union Européenne) constituent des catalyseurs qui encouragent les firmes à se lancer à l’international.
Mise en Œuvre de la stratégie d’internationalisation
Une fois la stratégie d’internationalisation définie sur le papier, il reste à la mettre en œuvre concrètement. Cela passe par un pilotage rigoureux du projet à travers plusieurs chantiers opérationnels. Tout d’abord, l’entreprise doit mobiliser les ressources internes nécessaires : constituer une équipe dédiée à l’international (ou faire monter en compétence des collaborateurs existants), allouer un budget spécifique, et prévoir les investissements matériels (usines, bureaux à l’étranger, stocks) ou immatériels (dépôt de marque, systèmes informatiques multilingues).
Ensuite, il est essentiel d’établir un calendrier détaillé avec des étapes clés : lancement sur un premier marché pilote, évaluation des résultats, ajustements, puis extension à d’autres marchés. Par ailleurs, la mise en œuvre implique souvent d’adapter l’organisation de l’entreprise : création de nouvelles fonctions (par exemple un service export), adaptation des processus logistiques et de la chaîne d’approvisionnement, et coordination accrue entre le siège et les équipes locales à l’étranger. Enfin, il convient de suivre des indicateurs de performance (chiffre d’affaires à l’export, part de marché à l’étranger, rentabilité des filiales, etc.) afin de piloter efficacement la stratégie et de corriger le tir si nécessaire.
Comment développer sa stratégie d’internationalisation
Développer une stratégie d’internationalisation solide exige une démarche structurée et réfléchie. Il est recommandé de procéder par étapes, en commençant par une étude approfondie de la situation de l’entreprise et de son marché domestique. Par exemple, l’entreprise doit évaluer si elle dispose des ressources financières et humaines suffisantes pour se lancer à l’international et si son avantage concurrentiel actuel est transposable à l’étranger. Ensuite, il convient d’analyser les différents marchés cibles potentiels pour identifier les opportunités les plus pertinentes.
Sur cette base, la stratégie pourra être formalisée en définissant les pays retenus, le positionnement de l’offre à l’étranger, le business model adapté à ces marchés, et le plan marketing international. Le développement d’une stratégie inclut aussi le choix des partenaires locaux éventuels, la mise en place de dispositifs logistiques pour exporter ou produire sur place, et la préparation des documents contractuels et juridiques nécessaires. Enfin, une fois la stratégie formulée, il sera temps de la mettre en œuvre progressivement en gardant une certaine agilité : l’entreprise doit être prête à ajuster sa stratégie en fonction des retours du terrain et des évolutions du marché international.
Les 5 différentes stratégies d’internationalisation
Dans la pratique, la littérature managériale distingue cinq grandes stratégies d’internationalisation qui orientent la façon d’aborder les marchés extérieurs :
- La stratégie de conquête d’un marché : Cette approche consiste à cibler en priorité un pays étranger pour y réussir son implantation. L’entreprise concentre ses efforts sur un marché à la fois afin d’y acquérir une position solide (par exemple devenir leader dans ce pays cible). Cette stratégie convient souvent aux entreprises qui préfèrent maîtriser un marché étranger avant d’en aborder un autre.
- La stratégie d’échelle : L’objectif ici est de déployer l’activité à grande échelle à l’international pour bénéficier d’effets de volume. L’entreprise cherche à mutualiser certaines opérations ou à standardiser son offre afin d’atteindre des économies d’échelle (réduction des coûts unitaires grâce à la production de masse pour plusieurs marchés). Cette stratégie se traduit, par exemple, par la mise en place d’usines de production à l’étranger pour approvisionner plusieurs pays à moindre coût, ou par la vente du même produit standardisé dans un grand nombre de régions du monde.
- La stratégie des ressources et compétences : Il s’agit d’internationaliser l’entreprise afin d’exploiter à l’étranger des ressources particulières ou de valoriser des savoir-faire distinctifs. Par exemple, une société peut décider d’implanter des unités de production là où certains facteurs de production sont moins chers ou plus abondants (main-d’œuvre qualifiée, matières premières). Inversement, une entreprise hautement innovante peut s’implanter sur des marchés étrangers pour exploiter à l’international une compétence spécifique et prendre une longueur d’avance sur ses concurrents.
- La stratégie de diversification : Ici, l’entreprise utilise l’internationalisation pour diversifier ses activités et ses sources de revenus. Elle peut lancer à l’étranger de nouveaux produits ou services différents de son offre domestique, ou adresser des segments de marché qu’elle ne touche pas dans son pays d’origine. Par exemple, une entreprise française peut profiter de son expansion à l’international pour proposer une gamme spécifique adaptée aux goûts locaux (variantes de produits, nouvelles marques), ce qui lui permet d’apprendre de nouveaux savoir-faire et de répartir ses revenus sur plusieurs marchés.
- La stratégie d’alliance : Cette approche repose sur la coopération avec des partenaires locaux ou internationaux pour pénétrer un marché. Plutôt que de s’implanter seul, l’entreprise s’allie à d’autres entités : cela peut prendre la forme de joint-venture (coentreprise avec un acteur du pays cible), d’accords de licence ou de fabrication locale, de franchise, ou de simples partenariats commerciaux. L’alliance permet de bénéficier du savoir-faire et des ressources du partenaire sur place, réduisant ainsi les risques liés à l’entrée sur un marché inconnu.
Les modes d’entrée sur les marchés
En parallèle de la stratégie générale, une entreprise doit choisir son mode d’entrée pour chaque nouveau marché visé. Le mode d’entrée correspond à la manière concrète dont l’entreprise va s’implanter ou opérer dans le pays étranger. Chaque mode présente des avantages et des contraintes différents en termes de coûts, de risques et de contrôle de l’activité locale.
| Mode d’entrée | Avantage | Inconvénient |
|---|---|---|
| Exportation directe | Investissement initial faible | Dépendance vis-à-vis d’un importateur local |
| Exportation indirecte | Intermédiaire gérant la logistique | Moins de maîtrise sur la vente finale |
| Licence / Franchise | Déploiement rapide via des partenaires | Contrôle limité sur la qualité ou l’image |
| Joint-venture | Partage des coûts et connaissances locales | Gestion complexe à deux entités |
| Filiale ou succursale | Contrôle total de l’activité | Investissement élevé et risques financiers importants |
| Acquisition d’entreprise | Implantation immédiate avec une base de clients existante | Coût très important et intégration parfois difficile |
Choisir sa stratégie d’internationalisation
Le choix d’une stratégie d’internationalisation appropriée dépend des caractéristiques propres à chaque entreprise et à son environnement. La taille de l’entreprise, son budget disponible, son secteur d’activité et son avantage concurrentiel influencent fortement la stratégie optimale. Par exemple, une petite start-up avec des moyens limités optera plutôt pour une stratégie prudente sur un marché test unique, alors qu’un grand groupe industriel pourra viser d’emblée une expansion sur plusieurs pays.
Il faut également tenir compte des caractéristiques des marchés visés : si le secteur est très réglementé ou culturellement éloigné, une alliance locale peut être préférable, tandis que pour un produit universel à forte valeur ajoutée, une stratégie d’échelle avec une offre standardisée dans plusieurs pays peut fonctionner. En somme, il s’agit de trouver l’adéquation entre les objectifs de l’entreprise, ses capacités et les spécificités des marchés ciblés pour choisir la stratégie la plus pertinente.
Les 8 étapes d’une stratégie d’internationalisation
- Étape 1 – Évaluer la viabilité du projet : L’entreprise doit d’abord analyser si son projet d’expansion à l’international est réalisable. Cela inclut un diagnostic interne sur la stabilité financière, la disponibilité des compétences et ressources humaines, ainsi que la capacité à augmenter la production et à gérer des activités à distance.
- Étape 2 – Choisir le pays cible et analyser le marché local : Une fois le principe de l’internationalisation acté, il faut sélectionner soigneusement le marché étranger le plus pertinent. Ce choix implique de réaliser une étude de marché approfondie sur le pays en question : taille du marché, croissance potentielle, concurrents locaux, attentes des consommateurs, contraintes culturelles et réglementaires, etc.
- Étape 3 – Déterminer le mode d’implantation : En fonction des résultats de l’analyse de marché et des ressources de l’entreprise, il convient de choisir le mode d’entrée le plus adapté (exportation, licence, joint-venture, création d’une filiale, etc.). Ce choix dépendra par exemple du capital disponible, de la nécessité d’un partenaire local imposée par la loi, ou du niveau de contrôle souhaité sur les opérations.
- Étape 4 – Établir un plan d’action : Il s’agit de formaliser une feuille de route pour l’expansion à l’international. Le plan d’action détaille les objectifs à atteindre (par exemple chiffres de ventes à l’export, part de marché à conquérir), les moyens financiers et humains dédiés, les principales échéances et un calendrier de déploiement, ainsi que les indicateurs de performance (KPI) pour suivre l’avancement.
- Étape 5 – Adapter l’offre au marché ciblé : Avant de lancer concrètement l’activité, l’entreprise doit s’assurer que ses produits ou services correspondent aux attentes du marché local. Cela peut impliquer des adaptations de produit (fonctionnalités, goûts, format, packaging) ou de positionnement (gamme de prix, image de marque) afin de mieux s’aligner sur la demande et la culture du pays ciblé.
- Étape 6 – Adapter la stratégie de communication : En parallèle de l’offre, la communication marketing doit également être localisée. Les messages publicitaires, le contenu du site web, les réseaux sociaux et même le nom de la marque ou du produit peuvent devoir être ajustés pour résonner avec la culture locale et respecter les codes du marché (langue, références culturelles, etc.).
- Étape 7 – Mettre en place des ressources multilingues : Pour être opérationnelle, l’entreprise doit disposer de documentations, de supports client et d’une organisation capable de fonctionner dans la langue du pays. Cela comprend la traduction des documents contractuels et légaux, la mise à disposition d’un service client dans la langue locale, et l’adaptation des systèmes informatiques (par exemple un site e-commerce gérant plusieurs langues et devises).
- Étape 8 – S’appuyer sur des professionnels spécialisés : L’internationalisation est un projet complexe, il est donc judicieux de solliciter l’accompagnement d’organismes et d’experts. En France, des organismes publics comme Business France, Bpifrance ou les Chambres de Commerce et d’Industrie proposent des conseils et aides aux entreprises qui se lancent à l’export. De même, faire appel à des consultants privés spécialisés en développement international peut aider à éviter les écueils et à accélérer la courbe d’apprentissage.
Le processus d’internationalisation
Le processus d’internationalisation se réalise souvent de manière progressive. Dans de nombreux cas, les entreprises commencent par exporter ponctuellement pour tester un marché, puis intensifient leurs exportations, ensuite établissent un bureau local ou une petite filiale commerciale.
À terme, si le marché étranger se développe bien, elles peuvent investir dans des infrastructures locales (usine, réseau de distribution) et intégrer ce marché à leur organisation. Ce cheminement par étapes permet de limiter les risques, car l’entreprise apprend à chaque étape du projet.
Cependant, toutes les entreprises ne suivent pas ce schéma linéaire. Avec la rapidité des communications et de la logistique moderne, certaines sociétés adoptent un processus plus accéléré. Par exemple, une jeune entreprise de logiciels en ligne peut dès sa création commercialiser ses services dans le monde entier sans passer par une phase d’exportation limitée.
Ainsi, le processus d’internationalisation peut être soit graduel, soit immédiat selon la nature de l’entreprise et les opportunités du marché mondial. L’important est de conserver une certaine souplesse dans le processus, afin de pouvoir ajuster la stratégie en fonction des enseignements tirés de chaque étape.
Sélectionner et cibler ses marchés pour s’internationaliser
Le choix des marchés à cibler est une décision stratégique déterminante dans le succès de l’internationalisation. Pour sélectionner les pays ou régions prioritaires, l’entreprise doit évaluer plusieurs critères :
- Le potentiel du marché : taille de la population, croissance économique, demande prévue pour le produit ou service.
- La distance géographique et culturelle : barrière de la langue, écart culturel, fuseaux horaires, distance logistique pour l’acheminement des produits.
- Le cadre politique et réglementaire : stabilité du pays, niveau de corruption, facilité à faire des affaires (procédures d’enregistrement, fiscalité, barrières douanières).
- La concurrence locale : présence d’acteurs déjà établis, part de marché à gagner, intensité concurrentielle et habitudes d’achat des consommateurs.
- L’accès aux ressources clés : disponibilité de partenaires ou distributeurs fiables, infrastructures (transport, énergie, internet) et éventuelles subventions ou avantages pour les investisseurs étrangers.
En pondérant ces facteurs, l’entreprise peut prioriser les marchés les plus attractifs et adapter sa stratégie pour chaque cible. Une bonne segmentation et analyse préalable évite de disperser les efforts et augmente les chances de réussite sur les marchés retenus.
Les bénéfices de la stratégie d’internationalisation
Lorsqu’elle est bien menée, l’internationalisation apporte de nombreux bénéfices à l’entreprise. Le premier avantage est bien sûr la croissance du chiffre d’affaires grâce à l’accès à de nouveaux clients. S’ouvrir à l’export peut fortement augmenter les ventes et générer des profits supplémentaires. Ensuite, l’entreprise en retire une plus grande résilience : en étant présente sur plusieurs marchés, elle est moins vulnérable aux aléas locaux (baisse de la demande dans un pays, changement réglementaire, etc.).
De plus, l’expansion internationale permet souvent de réaliser des économies d’échelle en augmentant la production, ce qui réduit les coûts unitaires et améliore la marge. L’entreprise peut aussi gagner en compétitivité en confrontant ses produits à des marchés différents : cela stimule l’innovation et la remise en question, ce qui peut améliorer son offre partout. Enfin, la présence à l’international renforce souvent la crédibilité et l’image de marque de l’entreprise : une marque mondiale jouit d’un prestige supérieur auprès de certains clients et partenaires, ce qui peut ouvrir de nouvelles opportunités (par exemple attirer des talents ou des investisseurs étrangers).
Les risques dans la stratégie d’internationalisation
Aucune stratégie internationale n’est dépourvue de risques. Plusieurs catégories de risques doivent être anticipées lors d’un développement à l’export :
- Risques politiques : instabilité du gouvernement, guerres, troubles civils ou nationalisations pouvant affecter la sécurité des opérations et des investissements dans le pays.
- Risques juridiques : différences dans les lois et systèmes juridiques étrangers. L’entreprise peut face à des litiges ou à des responsabilités civiles imprévues. Il est indispensable de disposer d’une assurance responsabilité civile adaptée pour se protéger en cas de poursuites ou de dommages causés à des tiers dans le pays d’accueil.
- Risques réglementaires : évolutions de la réglementation locale (changement de politique douanière, nouvelles normes techniques ou sanitaires, quotas d’importation) pouvant remettre en cause la viabilité de l’activité.
- Risques monétaires : fluctuations des taux de change pouvant diminuer la rentabilité des ventes à l’export ou augmenter le coût des approvisionnements. Une brusque dépréciation de la monnaie locale peut aussi réduire la valeur des revenus rapatriés.
- Risques liés aux catastrophes naturelles : certains pays sont exposés à des aléas naturels (séismes, inondations, épidémies) qui peuvent perturber gravement l’activité (destruction d’infrastructures, pénurie de main-d’œuvre temporaire, etc.).
- Risques de non-transfert : il s’agit de l’impossibilité de rapatrier les capitaux ou les profits depuis le pays étranger vers le siège. Ce risque survient par exemple si un État impose un contrôle strict des changes ou restreint les sorties de devises pour protéger ses réserves monétaires.
- Risques de solvabilité : ce risque concerne la fiabilité financière des partenaires et clients à l’étranger. Une entreprise exportatrice peut subir des impayés si un distributeur étranger fait faillite, ou perdre son investissement si un partenaire local n’a plus les moyens de financer sa part dans un projet commun.
Pour gérer ces risques, il est important de bien s’informer en amont, de souscrire aux assurances nécessaires (assurance-crédit export, assurances logistiques, etc.) et de prévoir des plans de secours. Une bonne stratégie d’internationalisation intègre toujours un plan de gestion des risques.
Aides et subventions pour sa stratégie d’internationalisation
De nombreux dispositifs d’aide existent pour soutenir les entreprises dans leur démarche d’internationalisation. Sur le plan financier, des subventions publiques peuvent être accordées pour aider à financer des études de marché ou la participation à des salons à l’étranger. En France, le dispositif d’Assurance Prospection de Bpifrance offre par exemple une avance de fonds pour couvrir une partie des frais liés à la prospection de marchés étrangers (voyages, recrutement local, traduction de documents). Il existe également des aides régionales ou européennes pour encourager l’export des PME.
Au-delà des subventions, des organismes spécialisés accompagnent les entreprises. Business France, l’agence nationale française, propose des services d’appui tels que des informations sur les marchés, l’organisation de rencontres d’affaires à l’étranger, ou la mise en relation avec des distributeurs locaux fiables.
Les Chambres de Commerce et d’Industrie ont aussi des programmes d’aide à l’export, notamment des formations et du mentorat par des entrepreneurs aguerris. Bénéficier de ces aides permet souvent de réduire le coût et les risques de l’internationalisation, surtout pour les entreprises de taille moyenne qui n’ont pas toujours toutes les compétences en interne.
La stratégie d’internationalisation des « Born Global »
Le terme Born Global désigne les entreprises qui, dès le début de leur activité, ont une vocation internationale. Contrairement aux schémas classiques où l’on s’internationalise après avoir consolidé sa position sur le marché national, les entreprises Born Global se lancent très tôt sur plusieurs marchés à la fois. Le plus souvent, il s’agit de jeunes entreprises innovantes, notamment dans le secteur des technologies ou du numérique, qui exploitent Internet et la numérisation pour toucher une clientèle globale sans attendre.
La stratégie de ces Born Global diffère par son agilité et sa portée immédiatement internationale. Par exemple, une start-up de logiciel SaaS peut proposer son application au niveau mondial via le web dès son lancement, en adaptant simplement son site en plusieurs langues. Ces entreprises misent sur un marché de niche mondial : plutôt que de cibler un pays, elles ciblent un segment de clients présent partout sur la planète (par exemple les passionnés d’un certain loisir technologique).
Souvent, les fondateurs eux-mêmes ont un profil international et conçoivent l’entreprise comme globale d’emblée. La stratégie Born Global valorise donc la rapidité et la présence multi-pays avant que les concurrents n’occupent le terrain, même si l’entreprise est encore de petite taille.
Exemples de stratégie d’internationalisation
Exemple 1 : La chaîne de restauration rapide McDonald’s illustre une stratégie d’internationalisation basée sur l’alliance locale. Pour entrer sur de nombreux marchés, McDonald’s a recours à la franchise : elle s’associe avec des entrepreneurs locaux qui opèrent les restaurants sous la marque.
Cette formule a permis à l’entreprise de s’implanter rapidement dans le monde entier tout en adaptant ses menus aux goûts nationaux (par exemple en Inde ou au Japon). L’alliance franchisée réduit l’investissement financier direct de McDonald’s et lui apporte la connaissance du terrain des partenaires locaux, assurant une expansion efficace.
Exemple 2 : La start-up française BlaBlaCar, spécialisée dans le covoiturage, a adopté une stratégie d’internationalisation rapide en Europe. Plutôt que de se développer pays par pays de façon organique, BlaBlaCar a choisi la croissance externe en rachetant des plateformes locales concurrentes (en Espagne, en Russie, en Allemagne, etc.).
Cette stratégie de conquête par acquisitions lui a permis de sécuriser rapidement des bases d’utilisateurs dans plusieurs pays et de devenir le leader européen du covoiturage en quelques années. L’exemple BlaBlaCar montre comment l’alliance et l’acquisition peuvent être utilisées pour accélérer l’internationalisation.
Le conseil en stratégie d’internationalisation et développement international
Face à la complexité de ces enjeux, de nombreuses entreprises font appel à du conseil en stratégie internationale. Des cabinets spécialisés en développement international accompagnent les sociétés dans leur projet d’expansion. Ces consultants apportent une expertise pointue sur les marchés étrangers, les pratiques à adopter et les erreurs à éviter.
Concrètement, un cabinet de conseil peut réaliser des études de marché ciblées, aider à élaborer le plan stratégique international, identifier et contacter des partenaires locaux de confiance, ou encore épauler l’entreprise dans les négociations et formalités administratives à l’étranger.
En recourant à un conseil externe, l’entreprise bénéficie d’un regard expérimenté et de réseaux d’affaires déjà en place. Cela peut accélérer la mise en œuvre de la stratégie et sécuriser le succès de l’internationalisation, notamment pour des PME qui ne disposent pas en interne de toutes les compétences nécessaires (juridiques, logistiques, interculturelles). Le conseil en développement international intervient également souvent sur le terrain en phase d’exécution, aux côtés des équipes, pour garantir le bon déroulement des opérations lors du lancement dans le pays étranger.
Les experts de l’internationalisation
Outre les consultants, les experts de l’internationalisation peuvent être intégrés directement au sein de l’entreprise. Il s’agit généralement de professionnels ayant déjà travaillé à l’étranger ou une spécialisation en commerce international. Par exemple, recruter un directeur du développement international qui a déjà exercé sur plusieurs continents peut apporter une vision stratégique et opérationnelle précieuse. De même, s’entourer d’experts sectoriels locaux (dans le pays cible) permet d’anticiper les difficultés spécifiques de ce marché.
Les experts en logistique, en douane, en droit international, en marketing interculturel ou en finance internationale jouent chacun un rôle clé dans la réussite du projet. L’internationalisation est par essence un effort pluridisciplinaire : impliquer des spécialistes de ces différents domaines aide l’entreprise à naviguer dans la complexité et à éviter les pièges d’une expansion mal préparée.
Les fondateurs
Les dirigeants fondateurs du cabinet Ipanovia, spécialisé dans le conseil en stratégie d’internationalisation, possèdent une expertise reconnue dans le développement des entreprises à l’étranger. Emmanuel Facovi, fondateur et Managing Partner d’Ipanovia, est un dirigeant multiculturel fort de plus de 30 ans de carrière sur trois continents. Expert du digital, de la data et du marketing international, il s’est spécialisé dans la transformation et la croissance des entreprises technologiques à l’échelle mondiale.
Svetlana Loginova Facovi, cofondatrice et Partner d’Ipanovia, est économiste et juriste de formation. Elle a exercé au sein de grands cabinets de conseil et de grandes entreprises internationales, acquérant une connaissance approfondie des aspects juridiques et administratifs du développement d’affaires sur de nouveaux marchés. Elle apporte ainsi son expertise pour sécuriser les volets réglementaires et contractuels des projets d’internationalisation.